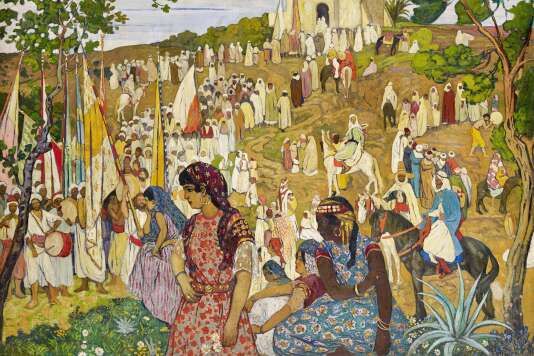
La peinture s’appelle L’Officier topographe et fait trois mètres de long. Au centre, l’officier, en blanc immaculé, casque compris, a l’œil à son théodolite, et un autre, tout aussi propre, observe on ne sait quoi avec une paire de jumelles. Autour d’eux, des terrassiers noirs, eux aussi en blanc impeccable, travaillent. Au fond, trois d’entre eux remplissent de terre un wagonnet. Ils ont des chapeaux de paille et des poses de jardiniers paisibles. C’est le chantier idéal, que survole un biplan, blanc. La toile fait partie d’un ensemble commandé à l’artiste André Herviault (1884-1969) pour l’Exposition coloniale de 1931. Elle est exposée au Quai Branly en compagnie de deux autres, de mêmes dimensions, et aussi idylliques, L’Officier constructeur et L’Officier administrateur, dans une exposition pudiquement intitulée « Peintures des lointains » qui devrait s’appeler « Exotisme et colonialisme dans la peinture française ».
Herviault est un spécialiste, Prix de l’Afrique-Equatoriale française, Prix de l’Afrique-Occidentale française. Il fait de nombreux séjours en Afrique. Il connaît son sujet et ne peut ignorer que l’image qu’il donne de la vie dans les colonies est fausse. Il le peut d’autant moins qu’en 1928, le journaliste Albert Londres suscite un scandale en publiant dans Le Petit Parisien le récit d’un voyage, « Quatre mois parmi nos Noirs d’Afrique », repris en volume, en 1929, sous le titre Terre d’ébène. Londres y décrit les épouvantables conditions dans lesquelles est construite la voie de chemin de fer Congo-Océan, de Brazzaville à Pointe-Noire. Il dénonce le principe du « travail forcé » qui autorise la Société de construction des Batignolles, chargée du chantier, à rafler des hommes dans les villages et à les réduire à un esclavage qui ne dit pas son nom. Les travaux, qui durent de 1921 à 1934, tuent 17 000 d’entre eux.
Le reportage de Londres met en rage les milieux politiques...


